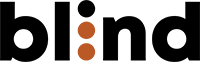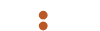L’exposition « Island Life », au Bristol Photo Festival, présente des clichés réalisés par certains des plus grands photographes britanniques de l’après-guerre. Cela a-t-il du sens ? Est-il nécessaire que cela en ait ?

Vous avez perdu la vue.
Ne ratez rien du meilleur des arts visuels. Abonnez vous pour 9$ par mois ou 108$ 90$ par an.
Déjà abonné ?