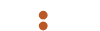Imaginez que vous vous rendiez dans un autre pays où un travail vous attend, dans l’espoir de subvenir aux besoins de votre famille restée au pays. Mais le travail n’est pas ce que vous pensiez. Votre passeport vous est retiré et vous devenez, dans la pratique, la propriété d’une autre personne. La photographe Aline Deschamps a rencontré de nombreuses femmes à Beyrouth qui partagent cette même histoire.
La plupart d’entre elles viennent du Sierra Leone. Enseignantes ou infirmières, elles ont été incitées à se rendre au Liban en croyant que le pays avait besoin de leurs profils professionnels. « Elles ont été recrutées sur des marchés, ou par des connaissances qui leur ont promis qu’elles pourraient gagner l’équivalent de 600 dollars par mois au Liban. Le voyage leur coûtait entre 500 et 1 500 dollars, et les recruteurs locaux prenaient normalement une part d’environ 100 dollars. Cela peut paraître peu, mais le salaire moyen en Sierra Leone est de 30 dollars par mois », révèle la photographe.


Une fois arrivées au Liban, le rideau tombe. Elles sont forcées d’entrer chez un « employeur ». Elles y font la vaisselle, les tâches ménagères et dorment sur le balcon, souvent sans recevoir la moindre rémunération pendant des mois. Lorsqu’elles appellent leurs agents pour comprendre ce qui se trame, toujours la même réponse : « Travaillez encore deux ou trois mois, on s’occupe du reste ». Si elles demandent à changer d’employeur ou à être rapatriées, elles sont menacées, battues, violées.
Au cœur du mécanisme qui rend possible ce type de traite des êtres humains, se trouve la Kafala, un système de tutelle dont les origines remontent à plusieurs siècles, mais qui est toujours légalement actif au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, au Liban, à Oman, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis pour contrôler les travailleurs immigrés.
La Kafala prévoit qu’un tuteur ou un sponsor, appelé “kafeel”, soit responsable du visa et du statut juridique du travailleur. Il établit également son salaire et ses conditions de travail. Ce système pernicieux permet aux tuteurs de retirer les passeports de leurs employés, de confisquer leurs téléphones et de les soumettre à des abus, le tout sans crainte de répercussions juridiques.
Au fil des ans, la Kafala a attiré l’attention du public et a été critiqué par les organisations de défense des droits de l’homme, notamment parce qu’il facilite l’exploitation des migrants qui construisent des stades, des musées, des îles artificielles et des immeubles résidentiels, participant ainsi à la croissance rapide des riches métropoles du Golfe. Il en va de même pour les travailleurs domestiques migrants, dont la plupart sont des femmes.

« En fait, votre vie dépend d’une seule personne », explique Aline Deschamps. « Peut-être que vous aurez un bon employeur qui vous paiera et qui ne vous enlèvera pas votre jour de congé, ni votre passeport, ou peut-être que vous aurez quelqu’un qui le fait. Les agents leur suggèrent de le faire. Elle ne se comporte pas bien ? Il suffit de l’enfermer et de lui retirer son passeport. C’est systématique ».
Alors que le recrutement et la contrebande depuis la Sierra Leone et d’autres pays sont illégaux, au Liban, un employeur potentiel peut se rendre dans de véritables agences, dont les vitrines proposent des salaires différents en fonction du pays d’origine du travailleur : « Disons que vous voulez embaucher quelqu’un d’un pays d’Afrique subsaharienne, vous paierez 250 dollars par mois. Les travailleurs asiatiques sont généralement plus chers. Les Philippins peuvent coûter environ 500 dollars parce qu’ils sont censés être plus doués pour le travail électronique. Tout cela est incroyablement raciste ».
Lorsqu’Aline Deschamps lance son projet en 2020, le Liban est au milieu d’un effondrement économique, dont il ne s’est toujours pas remis, causé par des années d’instabilité politique et économique. La pandémie du Covid aggrave la situation, et les travailleuses domestiques sont souvent jetées à la rue parce que leurs employeurs, ou leurs tuteurs, ne veulent plus être responsables d’elles.


C’est une organisation française qui signale à Aline Deschamps que plusieurs travailleuses migrantes sont bloquées dans un appartement. Leur nombre ne cesse d’augmenter, parce qu’elles accueillent d’autres femmes qui n’ont pas d’endroit où aller. Au fur et à mesure qu’Aline Deschamps apprend à les connaître, la façon dont elles répondent à ses questions dévoile un scénario bien plus sombre que celui qu’elle avait envisagé au départ.
« Elles n’avaient rien à manger. Elles ramassaient de la nourriture dans les poubelles. Elles n’avaient ni argent ni papiers, car ils avaient été confisqués. Au Liban, il n’y a pas d’ambassade pour la Sierra Leone qui puisse les aider à se faire représenter légalement, et les consulats sont gérés par des fonctionnaires libanais ».
Les femmes sans papiers ne sortent pas, même pour acheter des produits de première nécessité. Recluses, elles sont terrifiées à l’idée de tomber malades, car si elles se retrouvent à l’hôpital, elles risquent d’être envoyées en prison et expulsées. Certaines d’entre ayant perdu des proches à cause d’Ebola, elles redoutent le Covid, maladie contagieuse dont le niveau de dangerosité n’a pas encore été établi à l’époque.

Les photographies ne s’inscrivent pas dans la tradition documentaire. Elles montrent la lutte de ces femmes, sans pour autant leur coller une étiquette. Aline Deschamps les considère d’abord comme des individus et offre au spectateur la possibilité de se connecter « à la joie plutôt qu’à la douleur ».
Elles montrent les moments de lumière qui illuminent même les pires réalités, la revanche la plus puissante sur la main qui tente de briser le corps et l’esprit d’une personne.
Outre la fraternité qu’elles avaient établie entre elles, ce qui a aidé les protagonistes du projet à survivre à leur séjour au Liban, c’est le contact avec leurs familles. Pourtant, même cette relation était menacée : au fil du temps, certains maris ont perdu l’espoir de les voir revenir et ont décidé de couper les ponts. Envoyer une fille travailler au Moyen-Orient est un investissement coûteux pour les familles, qui vendent souvent des terres pour payer leur voyage, devenant ainsi vulnérables à la pression de leurs créanciers.
« Les femmes que j’ai rencontrées sont revenues à la maison sans argent, et parfois, en tant que parent, il est plus facile de dire “d’accord, ma fille est une menteuse. Elle est allée travailler pendant quatre ans, mais elle a gardé l’argent pour elle”. Il est plus difficile d’accepter que sa fille a été victime d’abus et de traite, et qu’elle a traversé de telles épreuves. »


Pour éviter que d’autres ne tombent dans le même piège, des femmes se sont rassemblées et ont fondé une organisation. C’est le cas de Lucy Turay. Enseignante, elle est partie au Liban peu après avoir accouché. Lorsqu’elle est revenue en Sierra Leone, sa fille de 3 ne la reconnaissait pas comme sa mère.
Dans les marchés où le recrutement a habituellement lieu, Lucy et d’autres femmes viennet protester, brandissant des pancartes et des haut-parleurs pour dénoncer le système les a réduites en esclavage. Lucy et ses alliées parlent également aux familles des autres femmes dès qu’elles reviennent du Moyen-Orient, essayant de leur expliquer ce qui est arrivé à leurs filles et de leur épargner le rejet.
En écho au titre du documentaire « I Am Not your Negro », sur la vie du militant des droits de l’homme et écrivain afro-américain James Baldwin, le projet d’Aline Deschamps s’intitule « I Am Not your Animal ». Il rappelle que la justification implicite de l’exploitation actuelle des travailleurs migrants au Moyen-Orient et dans le Golfe est la même que celle qui a été au cœur des atrocités commises aux États-Unis et en Europe au cours de l’histoire récente : si vous considérez quelqu’un comme moins qu’humain, vous avez le droit de le maltraiter, voire de le tuer.


En Sierra Leone, la photographe a pu renouer avec les femmes qu’elle avait connues au Liban. Elle en a aussi rencontré d’autres, récemment rapatriées du Koweït, d’Oman, d’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe. En regardant les images de « A Life After Kafala », la deuxième partie de son projet, rien ne laisse penser que les protagonistes du projet sont des employées de maison, ni qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains ou de viols.
« Je voulais que les photographies soient beaucoup plus douces et contemplatives, en contraste avec les dures réalités qu’elles ont endurées », explique Aline Deschamps.
Les images ouvrent une fenêtre sur la psychologie des femmes à différents stades de leur histoire. Le choc de la traite, la nostalgie du pays d’origine, le réconfort des nouvelles amitiés, la force de la lutte et l’effort pour réparer les relations interrompues. Elles nous rappellent que lorsque nous regardons quelqu’un, nous ne savons jamais ce qu’il a vécu.
Pour en savoir plus sur le travail d’Aline Deschamps, consultez son site web.