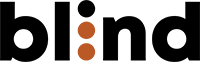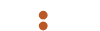Héritiers d’un temps suspendu, leurs images ne cessent d’enrichir l’histoire mondiale de la photographie et nos regards impatients. Souvenirs de quelques rencontres plus ou moins magiques avec ces virtuoses de l’objectif, solistes du noir & blanc ou de la couleur, artistes fidèles à l’argentique ou totalement envoûtés par le numérique. Aujourd’hui : Samuel Fosso, l’art de la multiplicité.

Vous avez perdu la vue.
Ne ratez rien du meilleur des arts visuels. Abonnez vous pour 9$ par mois ou 108$ 90$ par an.
Déjà abonné ?
Lire aussi : Omar Victor Diop, l’Afrique du futur